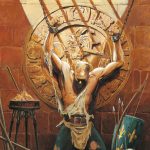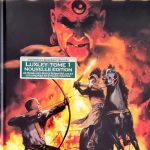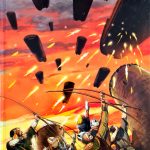Luxley est une série d’uchronie audacieuse, dans laquelle les rôles sont inversés : l’Europe et la chrétienté sont en danger, alors que l’Amérique précolombienne a envahit et règne sur le Vieux Continent. Un postulat de départ très original, que l’on pourrait presque qualifier de tendancieux, est pourtant le terreau d’une excellente aventure en BD. Trop méconnue !
Luxley
Pitch du premier tome - 1191. C'est la Troisième Croisade. La France et l'Angleterre attendent confiantes le retour de leurs rois Philippe-Auguste et Richard Coeur-de-Lion, partis combattre le sultan Saladin. Rien ne paraît pouvoir menacer l'Occident chrétien. Pourtant, l'inimaginable se produit. Une immense flotte de guerre aborde les rivages atlantiques de l'Europe. Et bientôt, une grande armée de Mayas, d'Aztèques et d'autres guerriers obéissant à un mystérieux Inca entreprend une invasion sanglante et systématique de la Chrétienté désarmée. 300 ans avant Christophe Colomb, le Nouveau Monde a osé envahir l'Ancien : l'Histoire vient de basculer. Huit années ont passé. Ceux que tous appellent les Atlantes dominent l'Europe. Seules quelques poches de résistance existent encore çà et là. Pourtant, tout ne peut pas être perdu. Le chevalier Robin de Luxley, dit Robin des Bois, en est persuadé. En mission secrète pour le roi Richard, il est malheureusement capturé près de Paris par Vucub-Noh, le gouverneur atlante de la France. Au cœur de la forteresse du Louvre, le vieux sorcier inca va s'amuser sadiquement avec son prisonnier Robin, dans une partie où se jouera la liberté des derniers rebelles, la survie de Louis VIII, le jeune roi de France, et le destin bouleversé de l'Europe toute entière.

Notes moyennes des albums
- Tome 1 : Le mauvais oeil - 8 / 10
- Tome 2 : Seinte Inquisition - 8.7 / 10
- Tome 3 : Le sang de Paris - 7.7 / 10
- Tome 4 : Le sultan - 7.7 / 10
- Tome 5 : Le nouveau monde - 6 / 10
Articles chronologiques liés à la série
En savoir plus sur la série...
Editeur : Quadrants
Nombre total d'albums :
5 tomes
Avancement : Série terminée